Salut les tennismen de merde !
Je me sens tout bizarre aujourd’hui. Hier, mardi 13 décembre 2016, j’ai enfin fait mon grand come-back à la compétition tennistique, près de 10 ans après mon dernier match officiel, et plus de 2 ans après l’avoir « publiquement » annoncé par l’ouverture de ce blog. Oui, il a fallu le temps…
Ceux qui ont lu mon unique article écrit jusqu’alors sur ce blog connaissent le contexte. Pour les autres, je vous fais un bref résumé : mon histoire, c’est celle d’un tennsiman de merde, donc, sans grand talent naturel, mais avec un esprit teigneux, qui a réussi à accéder au glorieux classement de 15/2 au prix d’une saison « chatteuse » où j’ai usé de toutes les ficelles tactiquo-psychologiques possible pour gratter quelques matches face à de jeunes adversaires en pleine ascension mais encore un peu tendres. A l’issue de cette saison-là, je me suis pris pour une star et je peux d’autant plus le faire aujourd’hui que ce classement est désormais la barre minimale requise pour passer le monitorat de tennis. Et oui les gars, je peux être prof ! En réalité, ce serait un épouvantable hold-up, presqu’une insulte au tennis. Car si je regarde deux secondes les choses en face, je ne suis qu’un tennisman de merde, avec un mental de merde qui a cumulé tous les défauts possibles et imaginables que l’on a tous un peu au fond de nous, les tennismen de merde, sans forcément se l’avouer. Bref, mon histoire, c’est celle de beaucoup d’entre vous, je pense.
Après une longue cure de désintoxication, donc, passée à me laver le cerveau et m’éloigner le plus possible de cette maladie qui rend fou appelée tennis, j’ai fini par replonger. Le virus en question m’a rattrapé, guéri (pensais-je) de ses effets secondaires. Bien au-dessus de tout ça désormais. Beaucoup plus mature et posé.
J’ai donc décidé de revenir à la compétition et ça m’a pris plus de temps que prévu, le temps de soigner un bobo devenu chronique (et certainement psychosomatique), de retrouver un club, des partenaires, et m’entraîner un minimum. Après plusieurs mois de reprise en douceur, avec des partenaires d’un niveau ventre mou de la 4è série, j’ai commencé à retrouver de bonnes sensations. J’avais même l’impression d’avoir trouvé la clé d’un revers enfin stable et régulier, bien aidé par les conseils de mon nouveau professeur. Et quand celui-ci m’a proposé de m’inscrire pour le tournoi interne du club, j’ai dit : « banco ! »
Aussitôt connu le nom de mon adversaire, je l’ai « googelisé », « facebooké »…
Le grand jour, c’était donc hier. Devant les autres, je l’abordais d’un air faussement détaché, genre ouais, je sais pas contre qui je joue, etc. Histoire sans doute de m’ôter la pression que je sentais revenir au grand galop. En réalité, j’ai fait comme tout un chacun : aussitôt connu le nom de mon adversaire, je l’ai « googelisé », « facebooké », « checké » son palmarès sur l’Espace licencié du site de la FFT… Un petit jeune classé 30/3 (et 30/1 à son meilleur), vraiment pas de quoi m’effrayer à priori. Mais vous connaissez le tennis. Entre les films qu’on se fait dans sa tête et la réalité du terrain, il y a un monde…
En fait, toutes les conditions étaient réunies pour me mettre la pression sur ce match : l’attente de mes nouveaux partenaires de club, forcément intrigués de voir mon vrai niveau, l’interdiction de perdre et même l’obligation de gagner largement, devrais-je dire. Même mon prof m’avait annoncé que je devais gagner sans problème !
Gagner, OK. Je vais lever ici ce suspense insoutenable : j’ai gagné, oui. Mais j’ai aussi été violemment rattrapé par tout ce que je voulais éviter pour ce retour : le stress, l’angoisse, le petit bras. Etonnamment, je suis arrivé sur le court plutôt détendu, peut-être parce qu’au sortir du boulot, je n’avais pas eu le temps de trop penser. Alors qu’avant un match, normalement, j’étais plutôt du genre à aller plusieurs fois aux toilettes (what else…). Là, je suis arrivé plutôt cool. J’avais de bonnes vibes au fond de moi et j’avais l’impression que j’étais parti pour faire un bon match.
Sensations confirmées lors des premières balles d’échauffement. La balle sort bien. Je fais certes mes deux ou trois « moon-shot » classiques sur mes premiers revers à deux mains, mais je n’ai pas le bras qui tremble, ce qui est plutôt bon signe. En même temps, inévitablement, je jauge l’adversaire. Je décèle très vite son revers crapoteux. Je me dis qu’au moins, on part à armes égales là-dessus. Je me la joue, encore une fois, faussement décontracté. C’est un petit jeune, on va pas commencer à sortir les bonne vieilles ficelles de vieux briscard alors que je reviens à peine à la compétition. Pourtant, il m’incite presque à le faire : malgré mes diverses injonctions, le blanc-bec – très sympa au demeurant – n’arrive pas à me tutoyer ! Merde, je me rends compte en effet que j’ai deux fois son âge. Que l’année où il est né, je faisais mes premières perfs en 3è série. Putain, j’ai encore l’impression d’avoir 18 ans, avec ma casquette à l’envers et mes illusions d’un geste de revers à la Agassi et d’un service à la Sampras. En fait, je suis un putain de vieux schnock de vétéran de merde ! Mais bon, soyons cool, « posey ». Après tout, ce n’est qu’un petit match de merde entre tennisman de merde. Je vais bien, tout va bien.
Mon revers ? Ce n’est pas un chop, c’est une espèce de bolduc saucissonné…
On attaque le match, dans notre gymnase d’un autre âge, surface en résine bien poncée, tendance ultra-rapide… Premier point, je sors la bonne vieille tactique de renard. Montée en chop sur le revers. En 4è série, ça marche presque à tous les coups. Ça ne rate pas, le blanc-bec me sort un passing de revers qui atterrit directement sur le mur du fond de court, et manque d’éteindre au passage le commutateur électrique ! Voilà, on y est, là, dans ces bons vieux matches de merde. Je joue les fiers-à-bras, prend ma respiration, remet mes cordes en place mais en fait, je prends directement conscience d’une horrible réalité : si je suis monté de suite au filet, c’est moins par calcul tactique que par incapacité à faire autre chose. Je me rends compte, ça y est, que j’ai le bras qui tremble et que je suis incapable de tenir proprement la balle du fond de court. Et merde !
Attention : quand je dis incapable, c’est incapable ! Le coup droit, qui passait si bien à l’échauffement, et lors de mes derniers entrainements, finit régulièrement sa course dans le « O » de la charcuterie Morin, mécène du club. Tiens, en parlant de charcuterie. Côté revers, je cisaille immanquablement dans un horrible geste tremblotant qui a au moins le mérite d’envoyer la balle dans le court, en général en plein milieu, façon jet d’eau. Ce n’est pas un chop, c’est une espèce de bolduc saucissonné. Mais je ne suis pas capable de faire autre chose. Mon revers à deux mains, que je pensais techniquement préparé au choc, n’est plus qu’un immense champ de ruines. En fait, il n’est plus rien du tout. Il n’existe pas. Ce n’est pas que je ne veuille pas le frapper, c’est que je ne PEUX pas. Mon cerveau « bugue ». Mon corps refuse. J’opte systématiquement pour le coupe-jambon, sur lequel mon adversaire, je dois le dire, s’emplafonne avec une régularité tout aussi systématique. Presque désopilante, sauf tout mon respect.
Aidé cette arme de circonstance, et par quelques montées au filet bien orientées sur le canonball qui lui sert (lui aussi) de revers, je prends les devant au score et je remporte le 1er set 6/2. Mais je ne prends aucun plaisir. Je propose une véritable bouillie de tennis, sans consistance, sans fil conducteur, sans aucune dimension esthétique. Il y en a qui perdent avec un certain panache, en tentant et en réussissant parfois des jolis coups qui leur valent au moins quelques regards admiratifs. Moi, je fais dans l’épicerie de comptoir. Je suis une fourmi avec une raquette. Je fais mon petit tas en capitalisant sur les déchets de mon adversaire mais très honnêtement, ce que je fais est indigne d’un ancien 15/2. D’ailleurs, j’ai l’impression que cet ancien classement me fout la pression. Si j’étais un « vrai » 4è série, mon niveau serait tout à fait acceptable. La preuve, je mène. Là, j’ai honte de ce que je propose.
D’un coup, je décide de la jouer comme Nadal…
Le gain du 1er set ne me relâche en rien. Paradoxalement, c’est le fait de me retrouver tout près de me retrouver mené 2-0 au 2è qui m’aide un peu. A ce moment-là, je suis déjà quasiment enclin à « accepter » de me retrouver poussé au 3è set par un petit 30/3. J’en puise un petit soulagement et j’aligne quelques jeux assez corrects, avec même quelques coups droits plus ou moins lâchés à la clé. Mais il faut attendre que je me détache 5-1 dans le 2è set pour, véritablement, sentir pour la première fois une forme de relâchement. Et pour tenter enfin des revers recouverts, histoire de retrouver des sensations. Grosse ironie – ou connerie – de l’histoire : sur la première balle de match en ma faveur, je tente même un décalage revers. J’en suis aussitôt puni par un coup droit gagnant mais j’applaudis « sportivement » mon adversaire. En réalité, je ne suis pas inquiet. La victoire n’est qu’une question de secondes.
Deuxième balle de match. Accélération de coup droit dans la bande du filet. Troisième balle de match. Coup droit dans la bande du filet. Quatrième balle de match. Coup droit dans la bande du filet ! C’est une blague ? Il a mis un aimant ou quoi ? Je pousse un cri et je suis pris d’une terrible pensée : et si j’étais gangréné par la fameuse peur de gagner ? Cette seule pensée me paralyse et mon cerveau met tout en œuvre pour faire en sorte que ce soit effectivement le cas. Deux doubles fautes d’affilée ! Et voilà mon jeune et fougueux rival qui revient à 5-2. Il serre le poing. Je sens que les mouches ont changé d’âne. Je mène 6/2, 5-2 contre un joueur classé une série en dessous de mon « best ranking » et je trouve encore le moyen de penser que je peux perdre ce match. Le jeu d’après, je fais n’importe quoi, il revient à 5-3.
Heureusement, j’ai encore au fond de moi un éclair de lucidité qui me permet de ne pas céder à la panique. Je me dis qu’il est normal que ce match-là, celui de mon grand come-back, ne me soit pas offert sur un plateau d’argent. Que c’est à moi d’aller le chercher. C’est à moi de servir. Je me rappelle de la fameuse finale de Wimbledon 2008 quand Nadal, poussant les portes de sa destinée, était allé chercher son premier sacre londonien en faisant service-volée. Oui, on a des pensées très connes dans ces moments-là. Mais c’est exactement ce qui me pousse à faire, moi aussi, service-volée, en partant du constat qu’en face, le mec n’a quand même pas le retour de revers de Roger. Je me lance, et ça paye. 40-0, trois nouvelles balles de match.
Service-volée, à nouveau. Mon (en)volée de revers atterrit près de la ligne, mais du mauvais côté, me semble-t-il. Je fais un truc immonde. J’accepte la proposition de mon adversaire, qui n’est pas sûr de lui, de remettre deux balles. Si j’avais été vraiment fair-play, je lui aurais fait donné le point. Mais là, je suis tellement peu serein que je préfère m’en tenir à la sacro-sainte règle du « chacun arbitre son camp ». Un point plus tard, j’ai la victoire en poche. Mais je me rends compte que rien n’est réglé. Malgré les années qui ont passé, je reste un tennisman de merde. En ce sens, j’ai un peu échoué dans mon come-back. J’ai encore beaucoup de travail. Et ce blog de belles heures devant lui, du coup…
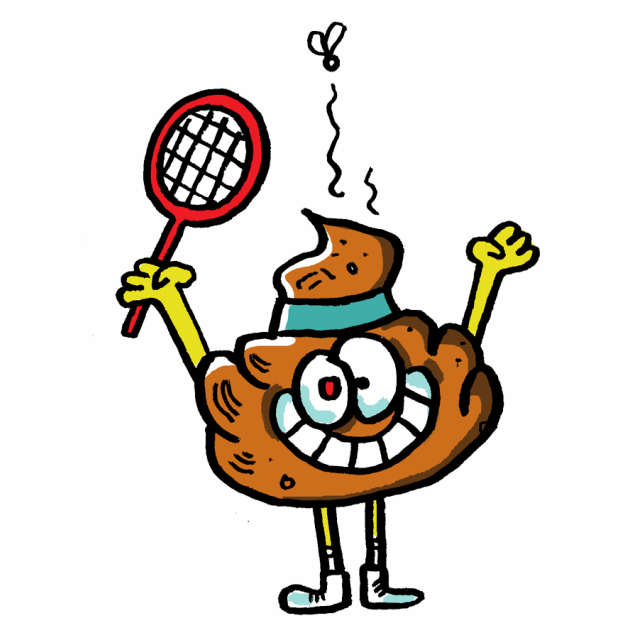

tellement bon!!!!