Un match de tennis passé à se battre contre soi-même, à pester contre la terre entière, à ne pas mettre une boulette dans le court… Il paraît que ça arrive même aux meilleurs. Mais c’est toujours insupportable à vivre…
Niveau de compétition : 3è tour.
Classement adverse : 15/4.
Surface : Terrain de 2 m de long, filet de 3 m de haut (dans ma tête).
Sensations : Envie de faire un barbecue avec ma raquette puis de me tailler les veines avec les cordes.
Magnitude d’énervement sur l’échelle de Benoît Paire : 9,5/10.
Salut à tous,
Bon, comme vous l’avez deviné, moi, ça va pas très fort ! Présentement, je suis dans un « mood » dépression nerveuse post-match de merde quasi comparable aux envies de suicides affichées par Alizé Cornet et Benoît Paire après leurs défaites à Indian Wells. A la différence que moi, je suis pas sous le coup de trois « no shows », je suis blessé nulle part et, de ce fait, je me croyais à l’abri du coup de bambou qui m’est, vous allez le voir, tombé sur le coin de la ganache.
Ce match, je pensais pourtant l’aborder dans les meilleures conditions, après deux précédentes victoires dont une à l’arrache contre un 15/5 (le fameux rameur), suivie d’une autre plus propre, bien qu’en trois sets également, à 15/4. Ce soir-là, c’est donc un autre 15/4 qui m’était proposé et si la montée en puissance de ces derniers jours se confirmait, sincèrement, il n’y avait aucune raison d’être pessimiste. A tout le moins, aucune raison d’envisager la grosse bouse tennistique que je m’apprêtais, pourtant, à proposer.
Un match flanqué du pyjama de Karlovic
Quand je vous dis qu’il n’y a pas de signe avant-coureur, ce n’est pas tout à fait vrai. En arrivant au stade, je me rends compte d’un sérieux problème : j’ai oublié mon short ! Je crois pouvoir dire fièrement qu’il s’agit là d’un fait unique dans l’histoire du tennis. Bon prince, mon adversaire me propose le deuxième qu’il a en stock (mais qui prévoit deux shorts dans son sac pour aller faire un match de tennis ??!). C’est sympa. Avec pour seul petit bémol qu’il mesure 20 bons centimètres de plus que moi. Je vais donc avoir le sentiment de jouer un match flanqué du pyjama d’Ivo Karlovic, ce qui m’embête un peu mais plus pour des considérations esthétiques – y’a deux meufs qui regardent depuis le club-house, la femme de mon adversaire et une copine à elle, et à chaque fois que je les vois se marrer, j’ai l’impression qu’elles se foutent de ma gueule – que sportives. Jouer en djellabah ne change rien à l’affaire, quand on sent pas ses coups, on sent pas ses coups.
En l’occurrence, à l’échauffement, je n’ai pas le sentiment de si mal sentir la balle. Les choses se gâtent vraiment brusquement à l’instant même où mon adversaire, un grand gaillard à la première balle surpuissante – mais à la deuxième balle négligemment balancée comme une boulette de papier à la corbeille – et au coup droit percutant – mais au revers plutôt cul-percé – a le toupet de me proposer de compter les points. De que-wah ? Compter les points ? Quelle drôle d’idée, ça va me stresser cette affaire. A peine le temps de le dire que mon tennis s’est déjà recroquevillé sur lui-même plus sûrement que Popaul par grand froid. Je gagne pourtant ce premier point d’une drôle de manière, un retour de coup droit qui touche 2 ou 3 fois le cadre de ma raquette (je sais même pas si c’est règlementaire, mais je prends) et produit au sol un rebond si capricieux que mon adversaire produit derrière un air-shot qui m’aurait fait hurler de rire si, déjà, je ne sentais pas les prémisses de la catastrophe. Il m’a fallu une fraction de seconde, dans ma façon de frapper (ou plutôt de « non frapper ») ce retour de coup droit, mais surtout dans l’analyse de la réaction cérébrale qui a précédé la non-frappe, pour saisir que je m’apprêtais à vivre des moments difficiles.
De fait, ça ne rate pas. Les minutes qui suivent ne sont qu’un long moment de solitude. Je me sens, mais alors, très, très seul ! La dernière fois que je me suis senti aussi seul, c’était, je crois, lors d’un oral blanc du bac de français (ça remonte un peu…) où j’avais dû plancher, devant trois trompe-la-mort hébétés, sur le texte d’un auteur dont je ne connaissais même pas le nom. Je balbutie totalement mon tennis. Mon coup droit joue les filles de l’air et part se promener où bon lui semble, dessinant des trajectoires d’une linéarité semblables aux prises de positions politiques de Giudicelli. Quant à mon rev.. (rires), hips, mon revers (pardon, j’ai du mal à l’appeler ainsi), on dirait qu’il a pris de la coke : il part très, très loin (dans les bâches) quand je décide de taper dedans, et redescend très, très bas (dans le filet) quand je décide de calmer le jeu. Euh, pardon mais un juste milieu, ce serait possible ? Ma main tremble comme une feuille morte à l’idée même de le frapper. Avec la « maturité » (lol), je me croyais à l’abri de ce genre de rechute tennistique. Mais non. Ce soir, c’est festival…
Mon revers aujourd’hui

Les jeux défilent, me voilà mené 4-0 en à peine un quart d’heure et je dois avouer qu’à ce stade, une pensée affreuse vient titiller mon esprit. N’ayant vraiment pas envie d’encaisser le premier 6/0, 6/0 de ma vie face à un gars qui n’a rien d’un foudre de guerre (il a été 15/3 à son meilleur), je commence à songer à l’abandon et plus précisément à la manière dont je vais simuler les raisons de celui-ci. Quelle blessure, quelle maladie, quel prétexte seraient-ils suffisamment crédibles pour justifier un niveau de jeu aussi scandaleusement nul ? Eh ben, je trouve pas. Du coup, je renonce à mon projet machiavélique. Je ferme ma gueule et je continue.
A 4-0, je fais un « reset » intérieur et je me dis qu’à partir de maintenant, le seul défi qui s’offre à moi – la victoire étant bien entendue exclue – reste de retrouver un semblant de sensation. Je jette un œil sur mon bracelet-cardio que j’ai pris l’habitude de garder pendant mes matches : 148 ! Ok, soit je suis en train de faire un infarctus, soit je suis en plein cauchemar (je pense que c’est plutôt ça), mais dans tous les cas, y’a une couille dans le potage car c’est quand même pas nos échanges à 5 coups de raquettes maximum qui me font monter autant le palpitant. Au moins, je m’en sers pour me fixer un but tangible, telle une bouée de sauvetage à laquelle me raccrocher : il faut qu’à la fin du 1er set, je sois repassé sous la barre des 100.
Je suis calme, je suis calme…

Je respire un grand coup à cet effet et, bizarrement, cette pensée va effectivement m’aider à me calmer un peu, tout comme le fait d’inscrire à ce moment-là mes premiers jeux. Pour être tout à fait sincère, je le dois autant au subit écroulement de mon adversaire qui, à la vue du « ouin-ouin » en robe de chambre qui lui fait face (moi), commence à se déconcentrer quelque peu. Autant il était plutôt solide jusque-là et faisait parfaitement voler en éclats ma faible résistance avec ses coups assez puissants, autant la façon dont il se met d’un coup lui-même à arroser les quatre coins du terrain devient assez intrigante. Même si j’ai accumulé trop retard pour envisager une « remontada » dans ce 1er set, je perds celui-ci sur un score bien plus décent que je ne l’envisageais quelques minutes plus tôt (6/3).
Le syndrôme de la « jenenmetsplusuneite » aigüe
Dans l’élan, toujours focalisé sur la seule et simple idée de rester le plus calme possible – ça fait longtemps que j’ai abandonné celle de bien jouer -, je prends assez vite les commandes dans le 2è set. Je suis aidé, outre par mon adversaire lui-même gravement atteint désormais par le syndrôme de la « jenenmetsplusuneite » aigüe, par un drôle de fait de jeu : j’ai repéré que nos balles, pourtant neuves au début du match, commencent sérieusement à fatiguer (je citerai pas la marque, mais n’achetez surtout pas ces balles Head). Notamment une en particulier, qui est limite au bord de la crevaison, au point que je me demande si elle n’appartient pas aux quatre touristes qui font un double sur le court d’à côté. N’empêche que je la garde, car ça m’arrange. En début de match, ces mêmes balles étaient des cailloux et je n’arrivais pas à les contrôler. Là, avec une balle en mousse, ça va mieux. Je peux tenir l’échange un peu plus et ça m’avantage clairement par rapport à mon adversaire qui, au contraire, voit la puissance de ses coups perdre en efficacité. C’est très très moche mais, sur mon service, je m’arrange donc systématiquement pour prendre MA balle. Et évidemment, je ne sers avec que des premières-deuxième, pour ne prendre le risque de la perdre. De toute façon, vu que ma première balle me rapporte moins d’intérêts qu’un Livret A, inutile de capitaliser dessus.
Là-dessus, les jeux défilent en ma faveur dans ce 2è set que je conclue 6/1 et honnêtement, vu la gueule de mon tennis et la physionomie du début de match, on est proche du miracle de Lourdes. Lourdes où mon adversaire serait maintenant bien inspiré de se rendre s’il souhaite retrouver l’usage de ses membres supérieurs pétrifiés par la cuisine indigeste que je lui ai proposée pour sauver les meubles : coups droits poussés, revers chopés, montées au filet pataudes et à l’aveuglette dignes d’une charge de CRS contre des hooligans du PSG, « moonballs » systématiques sur ses propres montées… Je fais vraiment dans la fin de série tennistique, dernière démarque des soldes, prenez-moi toute cette merde, c’est cadeau si vous voulez, mais tout doit disparaître. Je ne prends aucun plaisir, je ne joue que pour gagner.
Je me pavane devant le club-house, façon Aldo Maccione. Grossière erreur
Bref, me voilà en tout cas embarqué dans un troisième match consécutif en trois sets. Un 3è set dans lequel, poursuivant sur ma lancée, je prends les devants : 1-0. C’est tout sauf contrôlé, mais on s’en fout. A 30-30, pour n’avoir peut-être pas suffisamment mangé d’épinards dans ma jeunesse, je suis puni en étant un poil court sur un lob alors que le court s’offrait à moi. Dommage, c’est une première occasion ratée. Qu’importe. Il va y en avoir d’autres.
3-1 pour moi maintenant. J’entrevois la victoire et j’en souris presque, tellement ça relève du hold-up. 30-0 sur mon service. C’est bon, ça ! Un missile de coup droit me siffle alors aux oreilles. J’applaudis « sportivement » : à cet instant, je suis assez sûr de mon fait. Mais mon adversaire enchaîne et réalise, reconnaissons-le, un très beau jeu qui lui permet de revenir à 3-2. Je lui sers un « bien joué » un peu plus crispé. Mais je reste confiant. Je pense qu’il va lâcher.
A 3-2, 30-30, je refais le coup de la montée au filet et cette fois mon smash reste dans le court. Balle de 4-2. Je me pavane fièrement, façon Aldo Maccione, devant la vitre en plexiglas qui me sépare des 4 ou 5 spectateurs dans le club-house. Grossière erreur. Car derrière, double-faute. La première du match, putain ! Euh… Tu tombes très mal, ma cocotte. Ensuite, bien sûr, ça ne rate pas… enfin si, ça rate : 3-3. Tout est à refaire, mon cher Arsène.
Quand un revers « edbergien » se transforme en « rien »
A ce stade, je reste encore assez calme. Je me dis que le « momentum » est toujours de mon côté. D’ailleurs, me voici à 15-40, deux balles de 4-3. Mais comme je trouve que ça commence à faire beaucoup d’occasions ratées, je tiens absolument à concrétiser celle-ci et fatalement, je me crispe. Je manque la première en sortant un coup droit enfantin dans le couloir (mais quand je suis dans cet état, plus le coup droit est enfantin, moins mon bras passe) Sur la deuxième, mon retour de revers chipé se voulait « edbergien » – ça partait pourtant d’une très belle intention -, mais il se transforme en… « rien » du tout, finissant sa course mollassonne dans le filet.
Je vais rééditer exactement le même retour merdique sur la première balle de 4-3 pour mon adversaire. Celui-ci exulte. Et moi, je fonds un plomb : j’expédie ma raquette en colissimo, sans accusé de réception, près de ma chaise et je rejoins celle-ci en maudissant la terre entière. Je vais passer le changement de côté à pleurnicher sur mon sort, décrétant que ça fait 2 heures que je joue comme une pipe, que mon niveau de jeu est horrible, que c’est trop dur et que la neige, elle est trop molle pour moi. Une vraie pleureuse. On croirait Tommy Haas dans ce monologue de légende face à Davydenko à l’Open d’Australie 2007 :
Bon, la (toute petite) différence, c’est que moi, derrière, au lieu de relever la tête, je m’écroule. Pourtant, la vérité, j’essaye de m’accrocher ! Mais il est vrai que mon adversaire, que je pensais pourtant mourant, a repris du poil de la bête. Il a compris qu’il ne servait à rien d’attaquer, il se contente désormais de ramer et s’en sort plutôt bien. Je fais systématiquement la faute avant lui. Même si j’ai encore ma chance dans les deux derniers jeux, je finis par les perdre tous les deux et le match avec, sur un énième coup droit 2 mètres dehors.
La défaite, ce manque à gagner de bonheur…
Fin du supplice ? Même pas. Le début plutôt. Là encore, je pensais avoir pris un certain recul mais le contrecoup de cette défaite va vite me rattraper. Elle fait mal, putain ! Une victoire et c’était la montée à 15/4, peut-être même à 15/3 déjà assurée. Au lieu de quoi, je repars avec d’affreuses sensations dans la tête et cette impression d’avoir raté le cadre à 2 mètres du but, alors que le gardien était aux fraises. L’image tournera en boucle dans ma tête toute la nuit. Horrible sentiment que celui d’avoir des regrets…
Comme mon adversaire est plutôt sympa, je ne lui sors aucune excuse. Enfin, presque aucune. J’évoque quand même les bouchons rencontrés pour venir au stade comme possible explication à ma léthargie de début de match. C’est sans fondement, mais ça mange pas de pain et ça soulage. La vérité est bien sûr ailleurs. J’ai juste été pitoyable, j’ai fait un match pourri, avec un mental de chips. Il paraît que ça arrive mais quand c’est le cas, moi, ça a tendance à m’affoler car j’ai l’impression que ça ne reviendra jamais.
D’aucuns me diront que ce n’est pas grave. Effectivement, perdre au tennis, on n’en meurt pas. Mais c’est, disons, un petit manque à gagner de bonheur. J’aurais pu passer la soirée à me délecter de cette victoire arrachée sur moi-même. Au lieu de quoi, me voici rentré en semi-dépression tennistique, avec cette envie tenace de poser la raquette… jusqu’à la prochaine fois. Sport de m…, va !
Résultat : Défaite 6/3, 1/6, 6/3
Mon humeur sous la douche après le match :

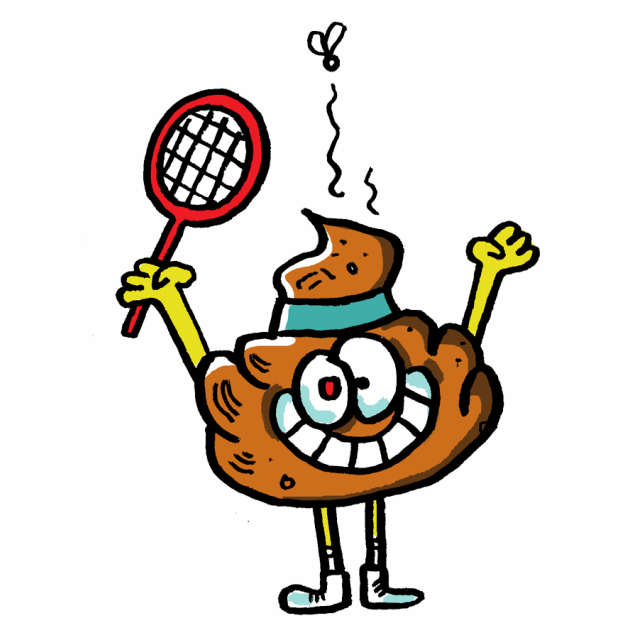
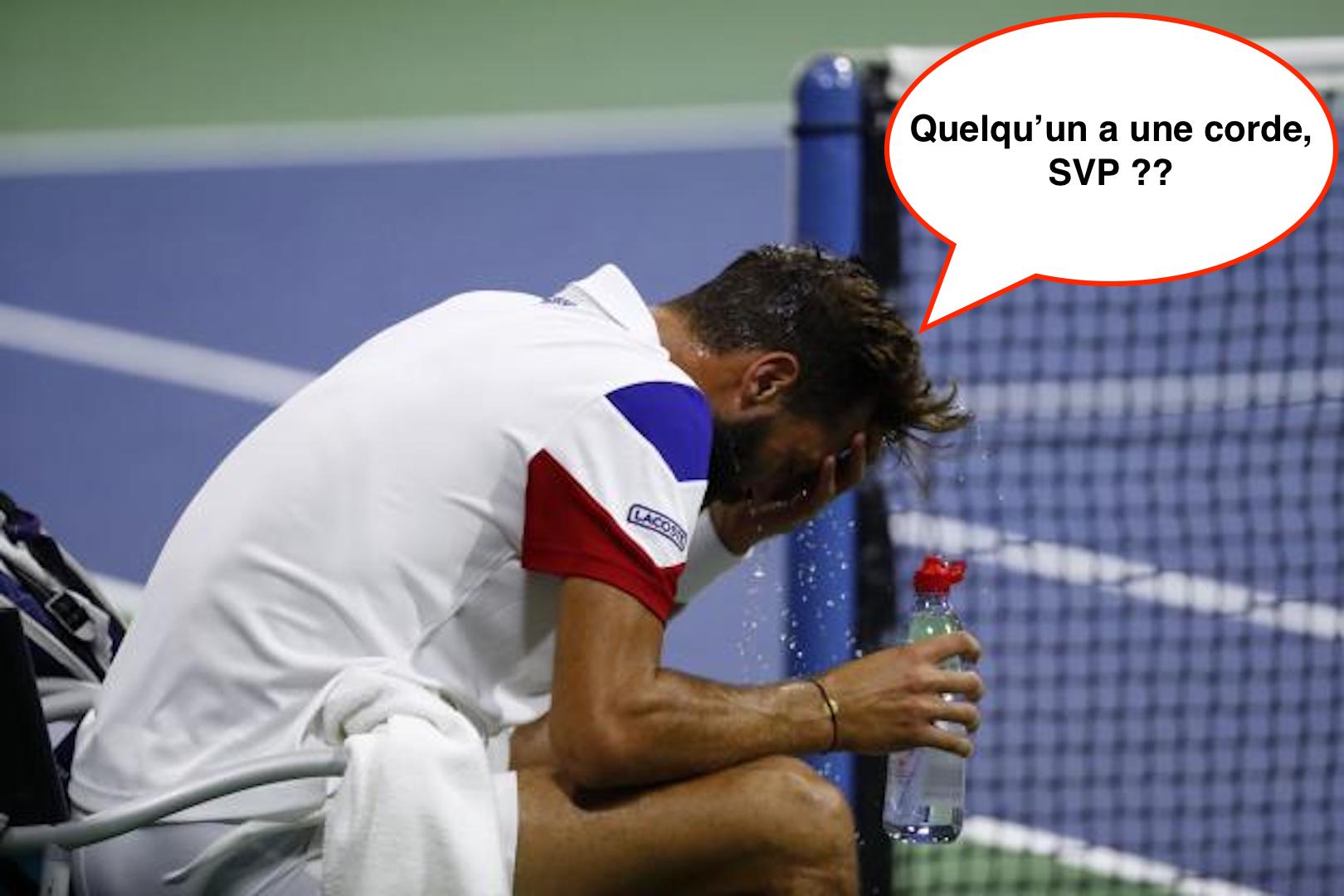
Courage.
nous sommes tous ce tennisman le nez dans l’idéal et les arpions fièrement planté dans l’étron de son œuvre.
Lève le nez plus haut et tu oublieras le fumet de la défaite.
Ca sera ton sursaut mental, la première branche à laquelle se raccrocher et sur laquelle finira par se poser la capricieuse colombe de la victoire.
Très poétique 😉
Mais tu as raison, ça se passe toujours comme ça.
La déprime dure 2 jours, et puis on passe à autre chose…
Très beau récit tragi-comique. Qui prouve une nouvelle fois que rien n’est malheureusement jamais acquis. On croit pouvoir prendre le contrôle du jeu par une technique aboutie, une confiance retrouvée, un relâchement imposé mais ce put… de cerveau – en une fraction de seconde – peut tout enrayer et c’est game-over…Et plus on pense à ce qui ne va pas, plus on veut y remédier, plus on s’enfonce…d’où ce titre de BLOG excellemment trouvé ! Quand on dit qu’il faut laisser le cerveau au vestiaire, c’est pas faux finalement ! Mais pas si simple…comme le reste… COURAGE et merci pour tes comptes rendus savoureux !
Cette défaite était si déprimante que plus un nouvel article en plus d’un mois ?
Ca y est ? Les raquettes sont raccrochées ?
Mais le printemps est là, les oiseaux chantent et les courts extérieurs nous attendent !! Courage ! Saint Nadal est avec vous !
J’espère bientôt un nouvel article sur un nouveau tournoi. C’est bien agréable de vous lire, je m’identifie complètement, même si je ne joue pas de tournois. Rien que les matchs « amateurs » que je pratique suffisent pour me reconnaître moi et mes adversaires réguliers.
Hey, merci de mettre des mots sur ce que je ressens. C est mon coup droit qui prend de la coke perso. Mon revers top.
De rien ! Si je peux aider… 😉 Merci pour ton message, en te souhaitant de bons matches.