Vous vous rappelez, du père spirituel de Benoît Paire que j’avais battu cette année lors d’un match épique en tournoi interne ? Eh bien, je l’ai retrouvé la semaine dernière pour un simple match d’entraînement qui a, de nouveau, basculé dans le grand n’importe quoi.
Surface : Résine intérieure passée à la ponceuse électrique (tendance ultra-rapide comme les gymnases omnisports de notre enfance, ceux avec les lignes de hand apparentes et le panneau de basket qui pend au-dessus de la ligne de service).
Classement adversaire : Heu… 30/1 (mais ça jouait un bon 15/4-15/3, hein !).
Résultat : Défaite 6/2, 3/6, 6/4.
Sensations : Passées en quelques jeux de Nishikori à Mannarino (lisez pour comprendre).
Magnitude d’énervement sur l’échelle de Benoît Paire : 8/10.
Salut à tous !
Comme vous l’avez vu, une certaine activité a repris sur mon blog depuis quelques semaines. C’est le signe que, oui, après quelques mois passés à soigner mon cerveau des dommages neuro-psychologiques causés par mon dernier tournoi (lire ici), je me suis décidé à reprendre la raquette, avec l’arrivée de la nouvelle saison et de la grisaille automnale qui me donne moins l’envie d’aller courir dehors.
J’ai donc repris le mois dernier avec de très bonnes intentions. Et une résolution : celle de changer de raquette. J’en peux plus de mes Wilson Open old-school (plus de 10 ans d’âge…) que j’estime aujourd’hui responsables de plus d’un revers boisé. Problème : cette raquette-là ne se fait plus, il m’en faut donc une nouvelle et c’est l’enfer pour se décider quel modèle acheter. A tel point que ça me donne envie d’en faire un article ultérieurement. Je prends date.
En attendant, c’est donc empli de la motivation seyante à tout #TDM en début de saison que j’ai poussé la porte d’un magasin spécialisé pour me faire prêter un modèle que je pensais susceptible de me convenir. Une Wilson Burn, pour ne pas faire de pub’. Parce que c’est quand même une raquette utilisée uniquement par des joueurs ou des joueuses au mental de chips, pêle-mêle Grigor Dimitrov, Kei Nishikori, Simona Halep ou Kristina Mladenovic. Y’a du lourd, là, non ? Bon, mais c’est pas des peintres non plus, hein. Alors je me dis que cette raquette doit avoir quelque chose, quand même. Et puis, elle est orange. Et j’aime l’orange.
Ce nouvel engin allait, en étais-je persuadé, me faire passer un sérieux cap. Oui, oui, à mon âge, je peux encore me laisser aller à ce genre de croyance. Il est vrai que les 3-4 premières séances étaient prometteuses. Assez cool, faut dire, ces premières séances. Juste mon heure et quart hebdomadaire de cours collectif avec les vieux 4è série de mon club, plus un ou deux doubles avec des collègues de travail sans talent ni ambition (je parle de leur niveau tennistique !) Des sessions sans rythme, sans pression, juste à la sensation. Je sais que c’est complètement illogique, mais quand je reprends la raquette après une longue période sans jouer, souvent, au début, mes sensations sont bonnes, très bonnes même. Comme si ce temps passé loin du terrain avait un effet cicatrisant sur les plaies sanguinolentes de mon mental en papier mâché. Il n’y a plus cette retenue, ce grain de sable, ce parasite cérébral qui finit immanquablement par étriquer, crisper, engoncer ma frappe (en revers essentiellement) quand je me laisse à nouveau gagner par le stress de l’enjeu.
C’est comme ça depuis des années, et pourtant, cette fois encore, j’ai eu la naïveté de croire que c’est ma nouvelle raquette qui avait des vertus euphorisantes sur mon jeu. De même, pour la 350è fois de ma vie, j’ai aussi eu l’impression d’avoir trouvé le petit « truc » technique qui allait guérir d’un coup de baguette magique toutes ces années de frustration sur mon maudit revers. Je suis le champion du monde de ces petits trucs techniques. Je réussis toujours à trouver quelque chose de nouveau. Ma liste est infinie. Cette fois, je devais faire attention à bien fermer le tamis à la frappe et enrouler celle-ci à l’accompagnement, façon bras en écharpe. L’autre jour, à l’entraînement, ça marchait tellement bien que j’avais le sentiment de pouvoir frapper des revers à l’infini sans faire une faute. Personne n’aurait pu me voler mes rêves à ce moment-là. Sauf que c’était des balles, simplement des balles. Et une illusion, une putain d’illusion…
Dès le premier point, mes rêves de grandeur s’envolent…
Survolté comme jamais par ces délicieuses sensations, je décide donc, la semaine dernière, de monter en puissance. Je convoque un vieux partenaire d’entraînement de niveau supérieur à mes faire-valoir précédents (je ne suis pas ingrat avec ces derniers, il y a toujours des moments où on est heureux de trouver des chèvres pour s’entraîner), mais que j’avais délaissé depuis quelques mois en lui laissant ma miséricorde comme seul mot d’excuse. Je lui propose un match d’entraînement pour le vendredi soir.
Je connais l’animal, je sais qu’il est animé par un terrible esprit de compétition. Vous le connaissez aussi puisque je vous avais fait, en début d’année, le récit d’un match gagné contre lui au tournoi interne. L’homme est sympa mais le joueur est fou. Sur un terrain, il se transforme. Il ne répond plus de lui-même. Il devient Hulk. C’est un schizophrène des terrains de tennis. Le père spirituel de Benoît Paire, je vous dis. La dernière fois qu’on s’est vu, à la fin, il était limite bon pour l’asile…
Je le retrouve ce soir-là… tout sourire, tout guilleret, détendu du gland comme jamais. Il me raconte l’évolution favorable de sa situation personnelle compliquée depuis quelques mois. Je m’en fous complètement, j’ai juste envie de taper des revers. Mais, par politesse, je suis quand même obligé de l’écouter me débiter sa joie de vivre et de jouer : « Maintenant, je suis complètement détaché, je joue vraiment pour le plaisir, et ça marche ! » Je ne peux m’empêcher d’esquisser un sourire intérieur. Comme si je pressentais le psychodrame à venir…
Comme toujours avec lui, au bout de 3 minutes, il me propose d’entamer un set. Pas de souci, je suis chaud. « J’vais le piler là, je sens grave la balle », pense-je. Ouais, franchement, je me sens bien. Ce soir, c’est mon soir.
Premier point du match. Royalement, je lui propose de servir le premier. Il m’expédie son petit service merdique habituel (un mouvement indéfinissable, on dirait qu’il cherche à dessiner un 8 dans l’air avec sa raquette) directement sur mon revers (il me connait aussi). Et là, et là, et là… D’un coup, je me fige et me crispe. Le tennis a décidément sa part de mystère que la raison n’explique pas. J’attendais tellement de moi-même un niveau de jeu élevé ce soir-là que j’ai dû me mettre inconsciemment trop de pression. J’expédie mon retour de revers directement dans la pancarte « charcuterie Morin » de la bâche du fond de court. D’un coup, mes rêves de grandeur s’envolent. Retour sur terre. Retour au point 0.
M’accrochant comme un damné à mes derniers espoirs, je tente pourtant de faire bonne figure mais rien à faire. Les premiers jeux sont serrés mais je les perds tous. Je pourrais pester contre toutes ces balles de jeux envolées, mais je sais bien que c’est plutôt le manque profond de sécurité que je ressens en moi ce soir-là, qui fait que tout tourne dans le mauvais sens. Au tennis, quand on a une mauvaise sensation, on met tellement d’énergie à lutter contre cette mauvaise sensation qu’on n’en a plus assez ensuite pour abreuver notre cerveau du calme intérieur indispensable dans les moments chauds.
Mon adversaire se détache donc, facilement. 3-0, 5-1, puis 6-2. Le pire, c’est qu’il fanfaronne ! « Je te dis, je suis plus calme depuis quelque temps, je pose mieux mon jeu. L’autre jour, j’ai joué avec Philippe (15/5), je lui ai mis 1 et 1. » Ouais, bon, j’avoue qui si je pouvais éviter une déculottée pareille, ça épargnerait mon ego.
« Manna », c’est ma nature

Je vais un peu me rassurer au début du 2è set. Paradoxalement, le fait de m’être pris une raclée au 1er m’a légèrement détendu. Désormais, j’accepte de mal jouer, j’accepte la défaite qui se profile. Oui, voilà, en fait c’est ça qui s’est passé au 1er set. Je m’attendais tellement à jouer le feu que je n’acceptais pas de jouer besogneux. Je me voyais Nishikori, avec ma Burn. Je suis Mannarino. Forcément, ça fait un choc. Il me fallait un temps d’acceptation.
Je dis ceci avec le plus grand respect pour Adrian. D’ailleurs, quand je dis que je suis Mannarino, je suis VRAIMENT Mannarino. Je me visualise en lui. J’ai ses gestes, son tennis posé, sa démarche tranquille, son flegme apparent. J’ai passé un set à canarder la salle dans ses moindres recoins en me prenant pour un joueur que manifestement je ne suis pas. Donc pour ce 2è set, je change de cheval. « Manna », donc. « Manna », c’est ma nature, désormais. Eh ben, rigolez-pas, parce que « Manna », ça marche ! Je me détache 3-0.
Mon ignare opposant n’a évidemment rien vu de ma transformation intérieure. Il estime que ce changement dans la physionomie du match est uniquement de son fait. « C’est toujours pareil : quand je m’applique, je gagne mais dès que je me déconcentre un peu, y’a plus rien qui rentre ! » hurle-t-il humblement à qui veut bien l’entendre, c’est-à-dire moi uniquement puisqu’il n’y a pas un rat à la ronde, à cette heure indue de la soirée. Je souris en constatant que les belles résolutions mentales qu’il m’exposait en préambule de notre partie sont en train de voler en éclats, façon Marcelo Rios contre Cédric Pioline à Roland-Garros en 1996 :
Les fameux vases communicants tennistiques ont une nouvelle fois prouvé leur efficacité. Infusion de verveine pour moi, shot de Red Bull en intraveineuse pour lui. Lors d’un changement de côté, il se confie comme à un psy : « L’autre jour, le prof m’a dit : « ce n’est pas que tu es mauvais, c’est que tu es 15/4, quoi (même pas : il est 30/1). » Sur le coup, je ne l’ai pas bien pris. Puis j’ai compris : dans ma tête, je pense pouvoir jouer comme un seconde série alors que dans les faits, c’est impossible, sinon je serais seconde série ! » Je m’incline devant cette brillante démonstration. Le gars vient de poser des mots sur la transformation mentale que j’ai opéré dans le 1er set. En fait, lui et moi, on est pareil.
Mais il ne parvient pas à remettre son interrupteur sur « ON » suffisamment tôt pour m’empêcher d’égaliser à un set partout en n’ayant, je crois, pas marqué plus de 2 points gagnants du set. Pas grave, je suis plus là pour faire le show. Juste pour gagner. Incroyable comme il est impossible de se détacher totalement du score même pour un simple match d’entraînement. Ceux qui prétendent l’inverse sont des menteurs. Ou alors, des extraterrestres.
Mais qu’est-ce qu’il fout, ce gardien ?!
A propos de bouton « ON », voilà deux jeux que nous évoluons dans une visibilité considérablement amoindrie. Un néon a en effet rendu l’âme en plein échange et je dois dire que c’est avec délectation que j’ai accepté sa proposition de remettre deux balles, tellement j’étais mal embarqué dans cet échange. Dans n’importe quel tournoi, cette perte de luminosité aurait été un prétexte tout à fait acceptable pour arrêter un match mal embarqué. Là, nous continuons. Merde, je menais 5-2 dans ce 2è set quand l’incident est arrivé, ce n’était quand même pas à moi de proposer à ce moment-là de mettre un terme au débat. De toute façon, me dis-je, le gardien du stade ne devrait plus tarder à se faire ce plaisir.
Lorsque débute ce 3è set, j’estime qu’il ne nous reste pas plus de 10-15´ de temps de jeu. Je suis donc relâché. Je ne peux pas perdre un set entier en si peu de temps. J’en suis là, perdu dans les méandres de ma psychologie positive, quand mon adversaire se lève prestement de son banc et me tance à voix haute : « Allez, un petit quart d’heure, c’est le temps qu’il me faut pour te mettre 6/0 ! ». Je lui jette un regard interdit. Il le pense vraiment, ou il bluffe ? Non, c’est impossible…
Je lance mon chrono. En 4 minutes, je suis déjà mené 2-0. Je viens de perdre les 8 premiers points de ce 3è set en alignant 8 fautes directes. Mon relâchement mental s’est en fait transformé en vrai coup de barre physique. Merde, me dis-je, à ce rythme, je vais vraiment finir par prendre ma bulle. Je m’accroche avec l’énergie d’un skipper sur son bateau en perdition. Commence alors un long bras de fer. Mon adversaire, je dois le dire, est lui aussi branché sur courant alternatif. Son jeu, comme le mien, c’est un coup « jour », un coup « nuit ». On dirait les néons de notre gymnase.
Le score évolue ainsi au rythme de nos égarements respectifs. 2-1, 3-1, 4-2, 5-3 pour lui… Tous les jeux sont terriblement disputés, ce 3è set est un long chemin de croix. Il est 22h30 et nous sommes toujours en plein champ de bataille. Mais je passe mon temps à courir après le score, en mode survie. Il faut être honnête, je suis dominé. Et ce foutu gardien qui n’arrive toujours pas pour me sauver par le gong. Le seul gong qui retentit, c’est celui de mon téléphone : un SMS de ma douce qui s’inquiète pour mon sort. Eh oh, fais gaffe, c’est un coup à me sortir du match, ça ! Cela dit, elle peut s’inquiéter, oui. Car là, je suis dans un état de délabrement psychologique avancé. Je ne suis plus ni Nishi, ni Manna, ni rien du tout. Mon revers est parti en état d’ébriété, il persiste à partir à la verticale quand je tente de le « frapper » à plat. Fini la fermeture du tamis, le bras en écharpe, ça marche plus du tout, ces conneries ! Je suis au bon vieux « chip » saucisson, là. Et pis c’est tout…
Les jambes d’Usain Bolt, l’esprit de Midas
Je me bats toutefois, comme un chien. J’ai retrouvé un second souffle, mais mon cerveau bouillonne. A un moment donné, alors que je venais de rater une volée toute faite sur un point qui m’aurait donné une balle de débreak (rires), enfin une balle pour revenir à 4-4, j’ai fissuré pour de bon. J’ai envoyé voler ma raquette à 20 mètres de moi, de l’autre côté du terrain. Et comme pour bien souligner mon misérabilisme, j’ai appuyé mon vilain geste d’une sentence sans appel : « de toute façon, je m’en fous, elle n’est pas à moi, cette raquette. » Cher vendeur, accepte mes excuses, je ne savais plus ce que je faisais…
Quelque chose en moi persiste à me dire que je ne peux pas perdre face à un mec qui incarne – sans doute encore plus que moi – la tennismandemerdattitude dans toute sa splendeur. Lui aussi fait fort : après un smash boisé, il fait exploser, d’un jet de balle bien senti, le panneau de score manuel accroché à la chaise d’arbitre. Je lui propose qu’on fasse accuser le gardien. Il rit, mais un peu jaune. Il veut absolument gagner, je le sens, car en fait, il ne m’a jamais battu. Je crois secrètement qu’il nourrit face à moi un petit complexe né de sa défaite dans notre seule confrontation officielle. Sinon, honnêtement, il m’aurait déjà achevé depuis un moment.
Donc, alors qu’il sert à 5-4, 40-15 dans ce 3è set, soit deux balles de match, j’y crois encore. Je réussis alors mes deux plus beaux points de la partie pour sauver ces deux points cruciaux. D’abord, je m’arrache au filet pour sauver d’un smash rageur, façon Pete Sampras – dans mes rêves… –, la première balle de match. Sur la seconde, je fais appel aux jambes d’Usain Bolt pour aller chercher une volée amortie au bout d’un échange à rallonge, puis je conjure l’esprit du roi Midas pour transformer cette volée de plomb en petit passing en or. Magique ! Mon adversaire me fixe longuement, incrédule. Puis, tout en entreprenant de se replacer, il se lance dans un monologue dont je ne saisis pas toutes les subtilités mais qui, je le subodore, ne doit pas forcément être très poétique. Pourtant, jurer en alexandrin, ça aurait de la gueule, non ? Jugez plutôt :
« Fi soit ce maudit sport,
Ça me casse les burnes,
De faire tant d’efforts
Sans jamais en mettre une ! »
Ce qui ne rime à rien, en revanche, c’est mon retour de coup droit baduf qui s’ensuit et qui provoque en une fraction de seconde l’anéantissement de mes deux « hot shots » précédents. Face à la troisième balle de match qui se profile, j’ai encore la foi, pourtant, pour me ruer à nouveau au filet. J’y suis fort bien installé, d’ailleurs. Mais, là, alors que je n’ai plus qu’à claquer ma volée de revers dans un court quasi désert (ouais, bon, les « y’a plus qu’à » ne veulent pas dire grand-chose dans ce genre de situation), il se passe un truc étrange. Une voix intérieure, venue d’on ne sait où (mon cerveau qui dit stop, peut-être ?), m’ordonne de laisser passer la balle. Clairement, elle va être couloir. J’écarte prestement ma raquette. Coup d’œil angoissé. Clairement, elle est pleine ligne… J’avoue, j’hésite à annoncer faute. Mon adversaire n’a rien pu voir, il sucre les fraises. Mais non, allez, je ne peux pas faire ça. S’en suit un dialogue à la Audiard.
– « Elle est bonne, putain ! Bravo à toi… »
– « Merci, je ne sais pas d’où je l’ai sorti, ce passing de revers. » (moi non plus…)
– « J’avais plus qu’à claquer la volée, pourtant. Mais là, honnêtement, j’en avais marre. »
– « On a fait un super match, ça jouait bien 15/3, là, non ? »
– « Ouais… Et facile 15 ans d’âge mental, aussi. »
Une chose est sûre : la Wilson Burn ne sera pas ma prochaine raquette.
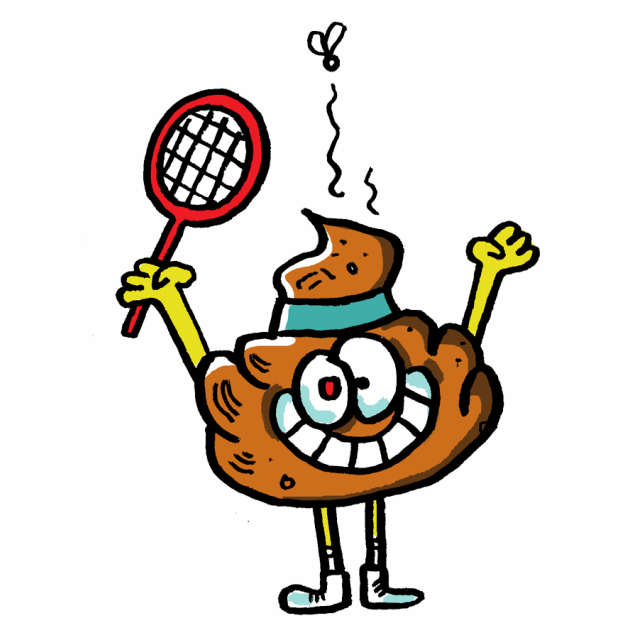

Excellent! C’est du même niveau que celui de Jean-Loup Dababie dans un article paru dans tennis magazine des années 80 intitulé « Sympa ce petit tournoi! »
Merci 😉
Cet article de légende figure évidemment dans ce blog, qu’il a beaucoup inspiré :
http://tennismandemerde.com/index.php/2017/03/03/les-choses-de-la-vie-interieure-par-jean-loup-dabadie/
Cette confrérie du coprotennis est un baume pour mon âme en perdition et ma psychologie d’ado sans exploits. Décomplexé par cette lecture et animé par la gratitude je m aventure dans une brève présentation clinique tout en regardant D un œil plein D ambition interdite mon fils de 4 ans qui defonce tout son groupe au mini tennis. (Ma chair et mon sang).
Ayant 10 fois son âge j entre dans cette période étrange où l on réalise soudain la médiocrité de son existence, ce qui décuple l attente de gratification dans le tennis, parenthèse symbolique ou l on rejoue entre quelques lignes le combat de sa vie. Puisque partout ailleurs on a cédé à la nécessité de composer avec le réel, le tennis devient cette enceinte sacrée où les ambitions renaissent intactes, oú l appétit de beau, de vrai et du bien creusent notre idéal. En dehors la demi mesure est la loi. Ici la quête chevaleresque de la perfection sinon du combat anime l impétrant qui soudain ne perçoit plus les limites de son souffle et l épaisseur de la couche de gras qui enrobe d humilité ses muscles. L homme de 40 ans est là tout neuf. Dans les langes de son appétit primordial. C est ainsi qu il aborde chaque match comme autant de pages blanches. La volonté virginale et l attention tendue comme un arc.
l’ecart de niveau déjà perceptible à l entraînement avec ce type cadet de 10 ans creuse son appétit de triomphe. Il n a pas vu un tournoi depuis la naissance de son 1er enfant qui a 6 ans mais cela ne doit pas l empêcher d en remontrer à cet ambitieux 15/4 – il aurait dû être 15/3 s il avait gratté quelques points. En effet son jeu est laid et ses genoux en dedans l’offrent au prédateur. Il
Suffira de jouer un peu solide. Car le quadragénaire ayant repris le tennis a 32 ans après voir été initié 4 ans durant son enfance cumule un âge mental de 12 ans. L âge de tous les rêves. Son jeu traversé de fulgurances le laisse croire qu il porte en lui de quoi bâtir les plus belles victoires. Il lui suffirait de baisser drastiquement le nombre de fautes qui sont comme l inévitable écume de la déferlante de son talent. Las, la réalité qu il ne perçoit qu une fois la lie de la défaite – 1 et 1 – avalée lui révèle une fois encore que l image est pertinente mais pas dans le sens qu il rêve : déferlante des fautes, ecume des insensées prise de risque. Il oubliera dès demain cette vérité amère, la congediera dans la soupente de l esprit de loose qu il pourchasse. Il retiendra le nombre important de jeux très disputés, de balles de break obtenues. Il suffirait de presque rien. Moins de fautes. Il jettera un voile pudique sur son attitude : une fois érodée et rapidement sa détermination notre quadra s est en effet laissé aller à quelques braderies et jet de dépit de balles et de raquette sous l œil faussement distant de l adversaire qui buvait du petit lait avec la modération qu il convient quand la victime se laisse ainsi aller les sphincters en vacances : tennisman de merde.
Excellent, je me suis bien bidonné à la lecture de ce post. Je joue en 3ème série et j’en vois des comme ça régulièrement. Vive la légèreté et le relâchement !
Je pense que nous, les 3è série, sommes les « pires » des joueurs de tennis. On veut jouer sérieux mais on est complètement crispé. Autant en rire…